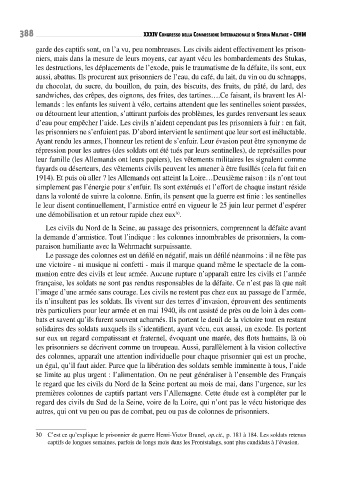Page 388 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 388
388 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
garde des captifs sont, on l’a vu, peu nombreuses. Les civils aident effectivement les prison-
niers, mais dans la mesure de leurs moyens, car ayant vécu les bombardements des Stukas,
les destructions, les déplacements de l’exode, puis le traumatisme de la défaite, ils sont, eux
aussi, abattus. Ils procurent aux prisonniers de l’eau, du café, du lait, du vin ou du schnapps,
du chocolat, du sucre, du bouillon, du pain, des biscuits, des fruits, du pâté, du lard, des
sandwiches, des crêpes, des oignons, des frites, des tartines….Ce faisant, ils bravent les Al-
lemands : les enfants les suivent à vélo, certains attendent que les sentinelles soient passées,
ou détournent leur attention, s’attirant parfois des problèmes, les gardes renversant les seaux
d’eau pour empêcher l’aide. Les civils n’aident cependant pas les prisonniers à fuir : en fait,
les prisonniers ne s’enfuient pas. D’abord intervient le sentiment que leur sort est inéluctable.
Ayant rendu les armes, l’honneur les retient de s’enfuir. Leur évasion peut être synonyme de
répression pour les autres (des soldats ont été tués par leurs sentinelles), de représailles pour
leur famille (les Allemands ont leurs papiers), les vêtements militaires les signalent comme
fuyards ou déserteurs, des vêtements civils peuvent les amener à être fusillés (cela fut fait en
1914). Et puis où aller ? les Allemands ont atteint la Loire…Deuxième raison : ils n’ont tout
simplement pas l’énergie pour s’enfuir. Ils sont exténués et l’effort de chaque instant réside
dans la volonté de suivre la colonne. enfin, ils pensent que la guerre est finie : les sentinelles
le leur disent continuellement, l’armistice entré en vigueur le 25 juin leur permet d’espérer
une démobilisation et un retour rapide chez eux .
30
Les civils du Nord de la Seine, au passage des prisonniers, comprennent la défaite avant
la demande d’armistice. Tout l’indique : les colonnes innombrables de prisonniers, la com-
paraison humiliante avec la Wehrmacht surpuissante.
Le passage des colonnes est un défilé en négatif, mais un défilé néanmoins : il ne fête pas
une victoire - ni musique ni confetti - mais il marque quand même le spectacle de la com-
munion entre des civils et leur armée. Aucune rupture n’apparaît entre les civils et l’armée
française, les soldats ne sont pas rendus responsables de la défaite. Ce n’est pas là que naît
l’image d’une armée sans courage. Les civils ne restent pas chez eux au passage de l’armée,
ils n’insultent pas les soldats. Ils vivent sur des terres d’invasion, éprouvent des sentiments
très particuliers pour leur armée et en mai 1940, ils ont assisté de près ou de loin à des com-
bats et savent qu’ils furent souvent acharnés. Ils portent le deuil de la victoire tout en restant
solidaires des soldats auxquels ils s’identifient, ayant vécu, eux aussi, un exode. Ils portent
sur eux un regard compatissant et fraternel, évoquant une marée, des flots humains, là où
les prisonniers se décrivent comme un troupeau. aussi, parallèlement à la vision collective
des colonnes, apparaît une attention individuelle pour chaque prisonnier qui est un proche,
un égal, qu’il faut aider. Parce que la libération des soldats semble imminente à tous, l’aide
se limite au plus urgent : l’alimentation. On ne peut généraliser à l’ensemble des Français
le regard que les civils du Nord de la Seine portent au mois de mai, dans l’urgence, sur les
premières colonnes de captifs partant vers l’Allemagne. Cette étude est à compléter par le
regard des civils du Sud de la Seine, voire de la Loire, qui n’ont pas le vécu historique des
autres, qui ont vu peu ou pas de combat, peu ou pas de colonnes de prisonniers.
30 C’est ce qu’explique le prisonnier de guerre Henri-Victor Brunel, op.cit., p. 181 à 184. Les soldats retenus
captifs de longues semaines, parfois de longs mois dans les Frontstalags, sont plus candidats à l’évasion.