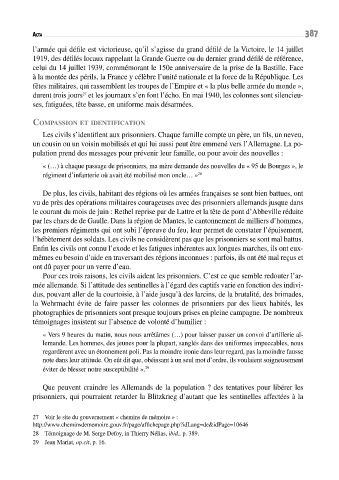Page 387 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 387
387
aCta
l’armée qui défile est victorieuse, qu’il s’agisse du grand défilé de la Victoire, le 14 juillet
1919, des défilés locaux rappelant la Grande Guerre ou du dernier grand défilé de référence,
celui du 14 juillet 1939, commémorant le 150e anniversaire de la prise de la Bastille. Face
à la montée des périls, la France y célèbre l’unité nationale et la force de la République. Les
fêtes militaires, qui rassemblent les troupes de l’Empire et « la plus belle armée du monde »,
durent trois jours et les journaux s’en font l’écho. En mai 1940, les colonnes sont silencieu-
27
ses, fatiguées, tête basse, en uniforme mais désarmées.
cOMPassiOn et identificatiOn
Les civils s’identifient aux prisonniers. Chaque famille compte un père, un fils, un neveu,
un cousin ou un voisin mobilisés et qui lui aussi peut être emmené vers l’Allemagne. La po-
pulation prend des messages pour prévenir leur famille, ou pour avoir des nouvelles :
« (…) à chaque passage de prisonniers, ma mère demande des nouvelles du « 95 de Bourges », le
régiment d’infanterie où avait été mobilisé mon oncle… » 28
De plus, les civils, habitant des régions où les armées françaises se sont bien battues, ont
vu de près des opérations militaires courageuses avec des prisonniers allemands jusque dans
le courant du mois de juin : Rethel reprise par de Lattre et la tête de pont d’Abbeville réduite
par les chars de de Gaulle. Dans la région de Mantes, le cantonnement de milliers d’hommes,
les premiers régiments qui ont subi l’épreuve du feu, leur permet de constater l’épuisement,
l’hébètement des soldats. Les civils ne considèrent pas que les prisonniers se sont mal battus.
Enfin les civils ont connu l’exode et les fatigues inhérentes aux longues marches, ils ont eux-
mêmes eu besoin d’aide en traversant des régions inconnues : parfois, ils ont été mal reçus et
ont dû payer pour un verre d’eau.
Pour ces trois raisons, les civils aident les prisonniers. C’est ce que semble redouter l’ar-
mée allemande. Si l’attitude des sentinelles à l’égard des captifs varie en fonction des indivi-
dus, pouvant aller de la courtoisie, à l’aide jusqu’à des larcins, de la brutalité, des brimades,
la Wehrmacht évite de faire passer les colonnes de prisonniers par des lieux habités, les
photographies de prisonniers sont presque toujours prises en pleine campagne. De nombreux
témoignages insistent sur l’absence de volonté d’humilier :
« Vers 9 heures du matin, nous nous arrêtâmes (…) pour laisser passer un convoi d’artillerie al-
lemande. Les hommes, des jeunes pour la plupart, sanglés dans des uniformes impeccables, nous
regardèrent avec un étonnement poli. Pas la moindre ironie dans leur regard, pas la moindre fausse
note dans leur attitude. On eût dit que, obéissant à un seul mot d’ordre, ils voulaient soigneusement
éviter de blesser notre susceptibilité ». 29
Que peuvent craindre les Allemands de la population ? des tentatives pour libérer les
prisonniers, qui pourraient retarder la Blitzkrieg d’autant que les sentinelles affectées à la
27 Voir le site du gouvernement « chemins de mémoire » :
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=de&idPage=10646
28 Témoignage de M. Serge Defoy, in Thierry Nélias, ibid., p. 389.
29 Jean Mariat, op.cit, p. 16.