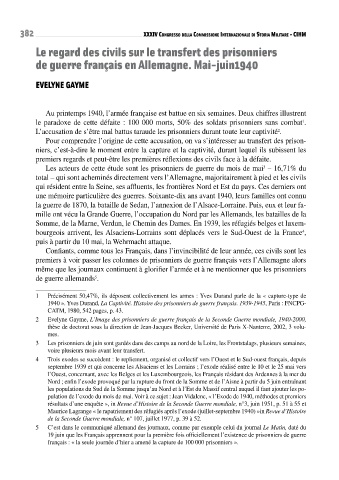Page 382 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 382
382 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
Le regard des civils sur le transfert des prisonniers
de guerre français en Allemagne. Mai-juin1940
EVELYNE GAYME
Au printemps 1940, l’armée française est battue en six semaines. Deux chiffres illustrent
le paradoxe de cette défaite : 100 000 morts, 50% des soldats prisonniers sans combat .
1
L’accusation de s’être mal battus taraude les prisonniers durant toute leur captivité .
2
Pour comprendre l’origine de cette accusation, on va s’intéresser au transfert des prison-
niers, c’est-à-dire le moment entre la capture et la captivité, durant lequel ils subissent les
premiers regards et peut-être les premières réflexions des civils face à la défaite.
les acteurs de cette étude sont les prisonniers de guerre du mois de mai – 16,71% du
3
total – qui sont acheminés directement vers l’Allemagne, majoritairement à pied et les civils
qui résident entre la Seine, ses affluents, les frontières Nord et Est du pays. Ces derniers ont
une mémoire particulière des guerres. Soixante-dix ans avant 1940, leurs familles ont connu
la guerre de 1870, la bataille de Sedan, l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Puis, eux et leur fa-
mille ont vécu la Grande Guerre, l’occupation du Nord par les Allemands, les batailles de la
Somme, de la Marne, Verdun, le Chemin des Dames. En 1939, les réfugiés belges et luxem-
bourgeois arrivent, les Alsaciens-Lorrains sont déplacés vers le Sud-Ouest de la France ,
4
puis à partir du 10 mai, la Wehrmacht attaque.
Confiants, comme tous les Français, dans l’invincibilité de leur armée, ces civils sont les
premiers à voir passer les colonnes de prisonniers de guerre français vers l’Allemagne alors
même que les journaux continuent à glorifier l’armée et à ne mentionner que les prisonniers
de guerre allemands .
5
1 Précisément 50,47%, ils déposent collectivement les armes : Yves Durand parle de la « capture-type de
1940 ». Yves Durand, La Captivité. Histoire des prisonniers de guerre français. 1939-1945, Paris : FNCPG-
CATM, 1980, 542 pages, p. 43.
2 Evelyne Gayme, L’Image des prisonniers de guerre français de la Seconde Guerre mondiale, 1940-2000,
thèse de doctorat sous la direction de Jean-Jacques Becker, Université de Paris X-Nanterre, 2002, 3 volu-
mes.
3 les prisonniers de juin sont gardés dans des camps au nord de la loire, les Frontstalags, plusieurs semaines,
voire plusieurs mois avant leur transfert.
4 Trois exodes se succèdent : le repliement, organisé et collectif vers l’Ouest et le Sud-ouest français, depuis
septembre 1939 et qui concerne les Alsaciens et les Lorrains ; l’exode réalisé entre le 10 et le 25 mai vers
l’Ouest, concernant, avec les Belges et les Luxembourgeois, les Français résidant des Ardennes à la mer du
Nord ; enfin l’exode provoqué par la rupture du front de la Somme et de l’Aisne à partir du 5 juin entraînant
les populations du Sud de la Somme jusqu’au Nord et à l’Est du Massif central auquel il faut ajouter les po-
pulation de l’exode du mois de mai. Voir à ce sujet : Jean Vidalenc, « l’Exode de 1940, méthodes et premiers
résultats d’une enquête », in Revue d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale, n°3, juin 1951, p. 51 à 55 et
Maurice Lagrange « le rapatriement des réfugiés après l’exode (juillet-septembre 1940) »in Revue d’Histoire
de la Seconde Guerre mondiale, n° 107, juillet 1977, p. 39 à 52.
5 C’est dans le communiqué allemand des journaux, comme par exemple celui du journal Le Matin, daté du
19 juin que les Français apprennent pour la première fois officiellement l’existence de prisonniers de guerre
français : « la seule journée d’hier a amené la capture de 100 000 prisonniers ».