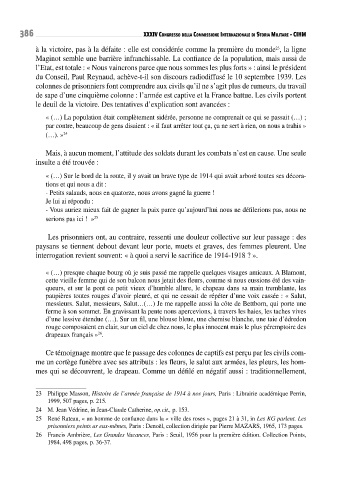Page 386 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 386
386 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
à la victoire, pas à la défaite : elle est considérée comme la première du monde , la ligne
23
Maginot semble une barrière infranchissable. La confiance de la population, mais aussi de
l’Etat, est totale : « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » : ainsi le président
du Conseil, Paul Reynaud, achève-t-il son discours radiodiffusé le 10 septembre 1939. Les
colonnes de prisonniers font comprendre aux civils qu’il ne s’agit plus de rumeurs, du travail
de sape d’une cinquième colonne : l’armée est captive et la France battue. Les civils portent
le deuil de la victoire. Des tentatives d’explication sont avancées :
« (…) La population était complètement sidérée, personne ne comprenait ce qui se passait (…) ;
par contre, beaucoup de gens disaient : « il faut arrêter tout ça, ça ne sert à rien, on nous a trahis »
(…). » 24
Mais, à aucun moment, l’attitude des soldats durant les combats n’est en cause. Une seule
insulte a été trouvée :
« (…) Sur le bord de la route, il y avait un brave type de 1914 qui avait arboré toutes ses décora-
tions et qui nous a dit :
- Petits salauds, nous en quatorze, nous avons gagné la guerre !
Je lui ai répondu :
- Vous auriez mieux fait de gagner la paix parce qu’aujourd’hui nous ne défilerions pas, nous ne
serions pas ici ! » 25
les prisonniers ont, au contraire, ressenti une douleur collective sur leur passage : des
paysans se tiennent debout devant leur porte, muets et graves, des femmes pleurent. Une
interrogation revient souvent: « à quoi a servi le sacrifice de 1914-1918 ? ».
« (…) presque chaque bourg où je suis passé me rappelle quelques visages amicaux. A Blamont,
cette vieille femme qui de son balcon nous jetait des fleurs, comme si nous eussions été des vain-
queurs, et sur le pont ce petit vieux d’humble allure, le chapeau dans sa main tremblante, les
paupières toutes rouges d’avoir pleuré, et qui ne cessait de répéter d’une voix cassée : « Salut,
messieurs. Salut, messieurs, Salut…(…) Je me rappelle aussi la côte de Bettborn, qui porte une
ferme à son sommet. En gravissant la pente nous apercevions, à travers les haies, les taches vives
d’une lessive étendue (…). Sur un fil, une blouse bleue, une chemise blanche, une taie d’édredon
rouge composaient en clair, sur un ciel de chez nous, le plus innocent mais le plus péremptoire des
drapeaux français » .
26
Ce témoignage montre que le passage des colonnes de captifs est perçu par les civils com-
me un cortège funèbre avec ses attributs : les fleurs, le salut aux armées, les pleurs, les hom-
mes qui se découvrent, le drapeau. Comme un défilé en négatif aussi : traditionnellement,
23 Philippe Masson, Histoire de l’armée française de 1914 à nos jours, Paris : librairie académique Perrin,
1999, 507 pages, p. 215.
24 M. Jean Védrine, in Jean-Claude Catherine, op.cit., p. 153.
25 René Rateau, « un homme de confiance dans la « ville des roses », pages 21 à 31, in Les KG parlent. Les
prisonniers peints ar eux-mêmes, Paris : Denoël, collection dirigée par Pierre MAZARS, 1965, 173 pages.
26 Francis ambrière, Les Grandes Vacances, Paris : Seuil, 1956 pour la première édition. Collection Points,
1984, 498 pages, p. 36-37.