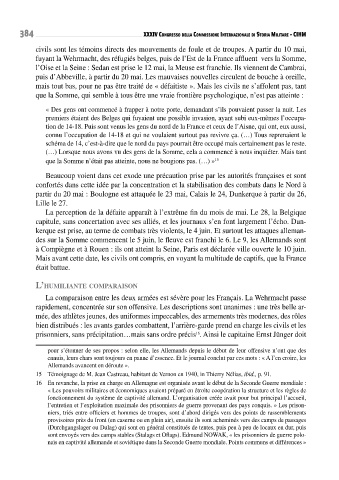Page 384 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 384
384 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
civils sont les témoins directs des mouvements de foule et de troupes. A partir du 10 mai,
fuyant la Wehrmacht, des réfugiés belges, puis de l’Est de la France affluent vers la Somme,
l’Oise et la Seine : Sedan est prise le 12 mai, la Meuse est franchie. Ils viennent de Cambrai,
puis d’Abbeville, à partir du 20 mai. Les mauvaises nouvelles circulent de bouche à oreille,
mais tout bas, pour ne pas être traité de « défaitiste ». Mais les civils ne s’affolent pas, tant
que la Somme, qui semble à tous être une vraie frontière psychologique, n’est pas atteinte :
« Des gens ont commencé à frapper à notre porte, demandant s’ils pouvaient passer la nuit. Les
premiers étaient des Belges qui fuyaient une possible invasion, ayant subi eux-mêmes l’occupa-
tion de 14-18. Puis sont venus les gens du nord de la France et ceux de l’Aisne, qui ont, eux aussi,
connu l’occupation de 14-18 et qui ne voulaient surtout pas revivre ça. (…) Tous reprenaient le
schéma de 14, c’est-à-dire que le nord du pays pourrait être occupé mais certainement pas le reste.
(…) Lorsque nous avons vu des gens de la Somme, cela a commencé à nous inquiéter. Mais tant
que la Somme n’était pas atteinte, nous ne bougions pas. (…) » 15
Beaucoup voient dans cet exode une précaution prise par les autorités françaises et sont
confortés dans cette idée par la concentration et la stabilisation des combats dans le Nord à
partir du 20 mai : Boulogne est attaquée le 23 mai, Calais le 24, Dunkerque à partir du 26,
Lille le 27.
La perception de la défaite apparaît à l’extrême fin du mois de mai. Le 28, la Belgique
capitule, sans concertation avec ses alliés, et les journaux s’en font largement l’écho. Dun-
kerque est prise, au terme de combats très violents, le 4 juin. Et surtout les attaques alleman-
des sur la Somme commencent le 5 juin, le fleuve est franchi le 6. Le 9, les Allemands sont
à Compiègne et à Rouen : ils ont atteint la Seine, Paris est déclarée ville ouverte le 10 juin.
Mais avant cette date, les civils ont compris, en voyant la multitude de captifs, que la France
était battue.
l’huMiliante cOMParaisOn
La comparaison entre les deux armées est sévère pour les Français. La Wehrmacht passe
rapidement, concentrée sur son offensive. Les descriptions sont unanimes : une très belle ar-
mée, des athlètes jeunes, des uniformes impeccables, des armements très modernes, des rôles
bien distribués : les avants gardes combattent, l’arrière-garde prend en charge les civils et les
prisonniers, sans précipitation…mais sans ordre précis . Ainsi le capitaine Ernst Jünger doit
16
pour s’étonner de ses propos : selon elle, les Allemands depuis le début de leur offensive n’ont que des
ennuis, leurs chars sont toujours en panne d’essence. Et le journal conclut par ces mots : « A l’en croire, les
allemands avancent en déroute ».
15 Témoignage de M. Jean Castreau, habitant de Vernon en 1940, in Thierry Nélias, ibid., p. 91.
16 en revanche, la prise en charge en allemagne est organisée avant le début de la Seconde Guerre mondiale :
« les pouvoirs militaires et économiques avaient préparé en étroite coopération la structure et les règles de
fonctionnement du système de captivité allemand. L’organisation créée avait pour but principal l’accueil,
l’entretien et l’exploitation maximale des prisonniers de guerre provenant des pays conquis. » Les prison-
niers, triés entre officiers et hommes de troupes, sont d’abord dirigés vers des points de rassemblements
provisoires près du front (en caserne ou en plein air), ensuite ils sont acheminés vers des camps de passages
(Durchgangslager ou Dulag) qui sont en général constitués de tentes, puis peu à peu de locaux en dur, puis
sont envoyés vers des camps stables (Stalags et Oflags). Edmund NOWAK, « les prisonniers de guerre polo-
nais en captivité allemande et soviétique dans la Seconde Guerre mondiale. Points communs et différences »