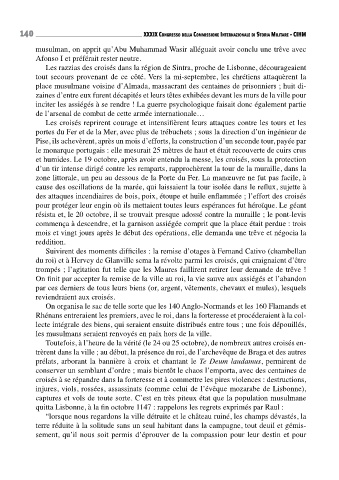Page 140 - Le Operazioni Interforze e Multinazionali nella Storia Militare - ACTA Tomo I
P. 140
140 XXXIX Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
musulman, on apprit qu’Abu Muhammad Wasir alléguait avoir conclu une trêve avec
Afonso I et préférait rester neutre.
Les razzias des croisés dans la région de Sintra, proche de Lisbonne, décourageaient
tout secours provenant de ce côté. Vers la mi-septembre, les chrétiens attaquèrent la
place musulmane voisine d’Almada, massacrant des centaines de prisonniers ; huit di-
zaines d’entre eux furent décapités et leurs têtes exhibées devant les murs de la ville pour
inciter les assiégés à se rendre ! La guerre psychologique faisait donc également partie
de l’arsenal de combat de cette armée internationale…
Les croisés reprirent courage et intensifièrent leurs attaques contre les tours et les
portes du Fer et de la Mer, avec plus de trébuchets ; sous la direction d’un ingénieur de
Pise, ils achevèrent, après un mois d’efforts, la construction d’un seconde tour, payée par
le monarque portugais : elle mesurait 25 mètres de haut et était recouverte de cuirs crus
et humides. Le 19 octobre, après avoir entendu la messe, les croisés, sous la protection
d’un tir intense dirigé contre les remparts, rapprochèrent la tour de la muraille, dans la
zone littorale, un peu au dessous de la Porte du Fer. La manœuvre ne fut pas facile, à
cause des oscillations de la marée, qui laissaient la tour isolée dans le reflux, sujette à
des attaques incendiaires de bois, poix, étoupe et huile enflammée ; l’effort des croisés
pour protéger leur engin où ils mettaient toutes leurs espérances fut héroïque. Le géant
résista et, le 20 octobre, il se trouvait presque adossé contre la muraille ; le pont-levis
commença à descendre, et la garnison assiégée comprit que la place était perdue : trois
mois et vingt jours après le début des opérations, elle demanda une trêve et négocia la
reddition.
Suivirent des moments difficiles : la remise d’otages à Fernand Cativo (chambellan
du roi) et à Hervey de Glanville sema la révolte parmi les croisés, qui craignaient d’être
trompés ; l’agitation fut telle que les Maures faillirent retirer leur demande de trêve !
On finit par accepter la remise de la ville au roi, la vie sauve aux assiégés et l’abandon
par ces derniers de tous leurs biens (or, argent, vêtements, chevaux et mules), lesquels
reviendraient aux croisés.
On organisa le sac de telle sorte que les 140 Anglo-Normands et les 160 Flamands et
Rhénans entreraient les premiers, avec le roi, dans la forteresse et procéderaient à la col-
lecte intégrale des biens, qui seraient ensuite distribués entre tous ; une fois dépouillés,
les musulmans seraient renvoyés en paix hors de la ville.
Toutefois, à l’heure de la vérité (le 24 ou 25 octobre), de nombreux autres croisés en-
trèrent dans la ville ; au début, la présence du roi, de l’archevêque de Braga et des autres
prélats, arborant la bannière à croix et chantant le Te Deum laudamus, permirent de
conserver un semblant d’ordre ; mais bientôt le chaos l’emporta, avec des centaines de
croisés à se répandre dans la forteresse et à commettre les pires violences : destructions,
injures, viols, rossées, assassinats (comme celui de l’évêque mozarabe de Lisbonne),
captures et vols de toute sorte. C’est en très piteux état que la population musulmane
quitta Lisbonne, à la fin octobre 1147 : rappelons les regrets exprimés par Raul :
“lorsque nous regardons la ville détruite et le château ruiné, les champs dévastés, la
terre réduite à la solitude sans un seul habitant dans la campagne, tout deuil et gémis-
sement, qu’il nous soit permis d’éprouver de la compassion pour leur destin et pour