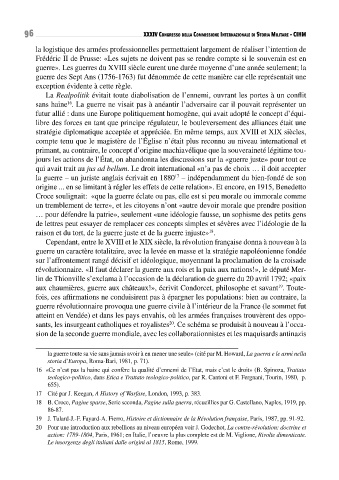Page 96 - Conflitti Militari e Popolazioni Civili - Tomo I
P. 96
96 XXXIV Congresso della CommIssIone InternazIonale dI storIa mIlItare • CIHm
la logistique des armées professionnelles permettaient largement de réaliser l’intention de
Frédéric ii de Prusse: «les sujets ne doivent pas se rendre compte si le souverain est en
guerre». Les guerres du XVIII siècle eurent une durée moyenne d’une année seulement; la
guerre des Sept Ans (1756-1763) fut dénommée de cette manière car elle représentait une
exception évidente à cette règle.
la Realpolitik évitait toute diabolisation de l’ennemi, ouvrant les portes à un conflit
sans haine . La guerre ne visait pas à anéantir l’adversaire car il pouvait représenter un
16
futur allié : dans une Europe politiquement homogène, qui avait adopté le concept d’équi-
libre des forces en tant que principe régulateur, le bouleversement des alliances était une
stratégie diplomatique acceptée et appréciée. En même temps, aux XVIII et XIX siècles,
compte tenu que le magistère de l’Église n’était plus reconnu au niveau international et
primant, au contraire, le concept d’origine machiavélique que la souveraineté légitime tou-
jours les actions de l’État, on abandonna les discussions sur la «guerre juste» pour tout ce
qui avait trait au jus ad bellum. Le droit international «n’a pas de choix … il doit accepter
la guerre – un juriste anglais écrivait en 1880 – indépendamment du bien-fondé de son
17
origine ... en se limitant à régler les effets de cette relation». Et encore, en 1915, Benedetto
Croce soulignait: «que la guerre éclate ou pas, elle est si peu morale ou immorale comme
un tremblement de terre», et les citoyens n’ont «autre devoir morale que prendre position
… pour défendre la patrie», seulement «une idéologie fausse, un sophisme des petits gens
de lettres peut essayer de remplacer ces concepts simples et sévères avec l’idéologie de la
raison et du tort, de la guerre juste et de la guerre injuste» .
18
Cependant, entre le XVIII et le XIX siècle, la révolution française donna à nouveau à la
guerre un caractère totalitaire, avec la levée en masse et la stratégie napoléonienne fondée
sur l’affrontement rangé décisif et idéologique, moyennant la proclamation de la croisade
révolutionnaire. «Il faut déclarer la guerre aux rois et la paix aux nations!», le député Mer-
lin de Thionville s’exclama à l’occasion de la déclaration de guerre du 20 avril 1792; «paix
aux chaumières, guerre aux châteaux!», écrivit Condorcet, philosophe et savant . toute-
19
fois, ces affirmations ne conduisirent pas à épargner les populations: bien au contraire, la
guerre révolutionnaire provoqua une guerre civile à l’intérieur de la France (le sommet fut
atteint en Vendée) et dans les pays envahis, où les armées françaises trouvèrent des oppo-
sants, les insurgeant catholiques et royalistes . Ce schéma se produisit à nouveau à l’occa-
20
sion de la seconde guerre mondiale, avec les collaborationnistes et les maquisards antinazis
la guerre toute sa vie sans jamais avoir à en mener une seule» (cité par M. Howard, La guerra e le armi nella
storia d’Europa, Roma-Bari, 1981, p. 71).
16 «Ce n’est pas la haine qui confère la qualité d’ennemi de l’Etat, mais c’est le droit» (B. Spinoza, Trattato
teologico-politico, dans Etica e Trattato teologico-politico, par R. Cantoni et F. Fergnani, Tourin, 1980, p.
655).
17 Cité par J. Keegan, A History of Warfare, London, 1993, p. 383.
18 B. Croce, Pagine sparse, Serie seconda, Pagine sulla guerra, récueillies par G. Castellano, Naples, 1919, pp.
86-87.
19 J. Tulard-J.-F. Fayard-A. Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution française, Paris, 1987, pp. 91-92.
20 Pour une introduction aux rebellions au niveau européen voir J. Godechot, La contre-révolution: doctrine et
action: 1789-1804, Paris, 1961; en Italie, l’oeuvre la plus complete est de M. Viglione, Rivolte dimenticate.
Le insorgenze degli italiani dalle origini al 1815, Rome, 1999.